

L’œil humain a un diamètre d’environ 24 mm, un volume de 6,5 cm3 et un poids moyen de 7 grammes. Cet organe est relié au cerveau grâce à 6 nerfs.
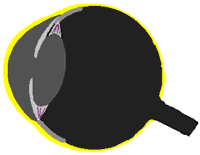 |
Deux parties très proches en position et en utilité : - La sclérotique est le blanc de l’œil. Elle est entourée d’une membrane très fine et transparente qui s’appelle la conjonctive. C’est elle qui donne la forme de l’œil. - La cornée et le prolongement le plus bombé de la sclérotique, elle est transparente donc laisse entrer la lumière dans l’œil. La cornée contient 78% d’eau. Pour maintenir ce degré d’hygrophilie, elle est recouverte en permanence par des larmes et répartis sur l’œil grâce aux clignements. De plus, c’est la seule muqueuse qui ne contient pas de vaisseaux sanguins, l’apport en oxygène se fait par l’air ambiant. Ces deux membranes permettent de protéger l’œil. |
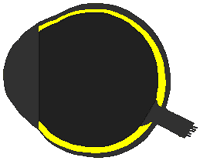 |
La choroïde est une couche riche en vaisseaux sanguins pour nourrir l’iris et la rétine. La choroïde est située entre la sclérotique et la rétine. De plus, elle contient de nombreux pigments colorés et forme un écran de telle sorte que l’intérieur de l’œil soit comme une chambre noire. |
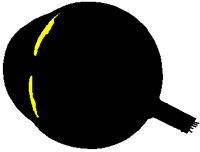 |
C’est ce qui donne la couleur à l’œil. Sa teinte dépend de deux choses : de la distance entre les lamelles pigmentaires et de sa concentration en mélanine (colorant de l’œil). L’iris permet de réguler la quantité de lumière qui rentre dans l’œil. C’est un diaphragme qui, lorsqu’il y a trop de lumière, se contracte pour réduire la pupille pour laisser passer moins de lumière. Au contraire, lorsqu’il n’y en a pas assez, l’iris se relâche pour agrandir la pupille pour laisser passer plus de lumière. |
Le muscle du corps ciliaire permet de modifier la forme du cristallin. Il permet de « faire la mise au point ».
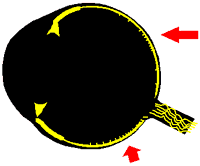 |
C’est une membrane nerveuse sensible. C’est elle qui capte la lumière. Elle tapisse le fond de l’œil avec 10 couches de cellules. La lumière pénètre à travers la pupille pour aller titiller les cônes et bâtonnets qui transmettent les informations au cerveau. Il y a 130 millions de bâtonnets et 6 à 7 millions de cônes. |
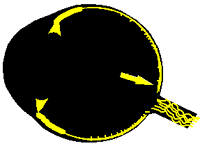 |
C’est une zone de la rétine où il y a une forte concentration en cônes. Cette concentration permet la vision nocturne. |
 |
Les cônes possèdent chacun 3 pigments visuels. Ces pigments visuels permettent de discerner les couleurs. Ainsi, chacun capte une des 3 couleurs primaires : rouge, bleu, vert. De plus, ils sont situés au centre de la rétine. Les bâtonnets servent quant à eux à la vision crépusculaire. Ils sont situés à la périphérie de la rétine. Ces derniers ont du mal à voir les détails mais sont très outils dans la pénombre. |
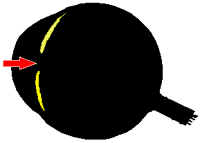 |
La pupille est un trou qui permet de laisser pénétrer la lumière jusqu’au fond de l’œil sur les cônes et les bâtonnets. La pupille change de taille grâce à l’iris pour laisser entrer plus ou moins de lumière (voir explication ci dessus). Son diamètre dans les conditions de lumière normale est entre 3 et 6 mm. |
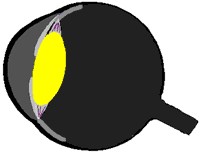 |
Le cristallin est une lentille transparente biconvexe. C’est à dire que la lentille nous sert d’objectif pour voir net. Son rayon de courbure peut varier et c’est grâce à cela que nous pouvons voir en faisant le point sur plusieurs distances différentes. La puissance normale d’un cristallin est de 16 d. |
 |
C’est un liquide transparent qui est constamment renouvelé. Ce liquide permet aussi bien de régulé la pression intraoculaire que de nourricier envers la cornée et l’iris. En effet, ce liquide, composé essentiellement d’eau, possède également de la vitamine C, du glucose, d’acide lactique et de protéines diverses et variées. |
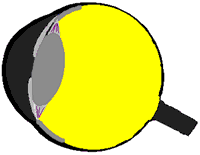 |
Le corps vitré est un peu comme un gilet par balle pour œil car il permet d’amortir les chocs grâce à sa masse gélatineuse (de couleur claire). Il compose à 90 % le volume de l’œil. Il permet de rigidifier l’œil. |
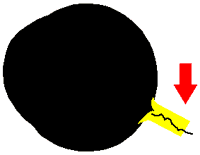 |
C’est lui qui permet de transmettre les images reçues par les cônes et les bâtonnets au cerveau. Les fibres optiques du fond de l’œil se rejoignent pour former le nerf optique. |
Si la luminosité change, la taille de la pupille change. Ainsi, si la lumière s’affaiblit, la pupille se dilate pour laisser entrer plus de lumière : c’est la mydriase. Au contraire, si la lumière augmente, la pupille se rétracte pour laisser passer moins de lumière : c’est le myosis.
En pleine obscurité, les bâtonnets ne suffisent pas à voir. Mais lorsqu’il y a très peu de lumière, nous la percevons sur les « cotés » car c’est là où sont disposés les bâtonnets. Donc pour apercevoir des objets en face de soit dans la plus profonde pénombre, il faut tourner la tête pour exposer le peu de lumière qu’il y a aux bâtonnets.